Je pense sans cesse aux femmes incarcérées
La pauvreté des femmes est criminalisée au lieu d’être reconnue comme une urgence sociale.

Depuis ma dernière chronique, je pense sans cesse aux femmes incarcérées. Aux femmes racisées incarcérées. Aux femmes autochtones aux prises avec des troubles de santé mentale incarcérées. Aux jeunes filles enfermées dans les prisons pour enfants de la province. Aux filles dont la mère est en prison. Aux femmes enceintes en prison. Aux mères dont la fille est en prison. Ça me tourne dans la tête sans arrêt, comme un mauvais refrain coincé sur repeat.
Au Canada, les femmes représentent à peine 5,8 % de la population carcérale.
Ça veut dire que 94 % des personnes en prison, ce sont des hommes.
On prétend souvent que si les femmes se retrouvent moins en prison, c’est parce qu’elles seraient par nature plus douces, plus calmes et moins violentes. En réalité, la sociologie féministe démontre que cette différence ne révèle rien d’une essence féminine, mais tout du contrôle social qui pèse sur les femmes. Leurs vies sont plus surveillées, plus contraintes et, surtout, plus exposées au jugement à la maison, dans la rue et dans leur milieu de travail. Si les femmes commettent moins de crimes, c’est parce qu’elles vivent dans des sociétés où leurs existences sont à la fois sursocialisées et surcontrôlées.
Soutenez un projet de journalisme indépendant.
Ça me fait toujours rouler des yeux quand j’entends dire que les femmes seraient, par nature, plus « dociles ». C’est facile d’oublier que cette docilité est le produit d’une peur intériorisée et d’un apprentissage précoce de la prudence aux fins de la survie. La faible criminalité féminine n’est pas la preuve d’une nature « pacifique », mais l’un des effets les plus discrets et les plus persistants de la domination masculine dans nos sociétés contemporaines.
Les hommes, à l’inverse, évoluent dans un système où la virilité est souvent associée à la transgression. Des exemples? Tester les limites, imposer sa force et dominer autrui. La masculinité, surtout dans les modèles patriarcaux, se construit par la conquête de l’espace, la compétition (amoureuse, sportive, capitaliste…il faut lire Le Boys club de Martine Delvaux) et la violence symbolique et physique.
Par ailleurs, c’est ce que Lucile Peytavin, essayiste et historienne féministe, appelle « Le coût de la virilité » dans son livre du même nom. Les mêmes mécanismes qui donnent aux hommes le privilège d’une liberté relative les exposent davantage à des comportements à risque, à la violence et à la répression pénale. Cette virilité n’est pas donnée. Elle coûte cher aux contribuables et à l’État, qui consacre chaque année des dizaines de millions à la police, à la justice et aux services médicaux et éducatifs pour en gérer les conséquences. Et c’est sans compter le coût indirect pour la société, qui absorbe les souffrances physiques et psychologiques des victimes, les pertes de productivité et les destructions que cette violence engendre.
Toutes infractions confondues, les hommes sont massivement surreprésentés dans les statistiques criminelles. Par contre, le vol à l’étalage fait partie des rares délits pour lesquels les femmes apparaissent aussi présentes, parfois même davantage, que les hommes. Un délit non violent, étroitement lié à l’accès à la nourriture, aux produits de première nécessité et aux vêtements pour enfants.
***
J’ai appris récemment que le lait maternel est désormais sous clé dans plusieurs magasins Walmart du Québec et dans certaines pharmacies ou épiceries à grande surface. Les sciences sociales le montrent depuis longtemps: le vol, ce n’est pas un échec moral individuel, mais une réponse située à des contraintes matérielles immédiates. On vole quand le temps manque et que les ressources financières sont épuisées. On vole quand l’urgence précède toute délibération abstraite sur ce qui est bien et ce qui est mal. Dans ces conditions-là, voler, ça devient l’option la plus accessible dans un champ de choix déjà mutilé par les précarités. Placer le lait maternel sous clé, c’est du marquage social. Et ce lait, une nécessité pour les nouveaux-nés, est déjà extrêmement dispendieux.


Selon Merissa Daborn, professeure adjointe en études autochtones à l’Université du Manitoba, dans The Conversation, « les détaillants aimeraient nous faire croire que le coût du vol alimentaire se limite au fait qu’ils refilent leurs pertes aux consommateurs. Or, leurs investissements dans la surveillance, la sécurité et les agents de police dédiés sont eux aussi refilés aux consommateurs : nous payons pour les systèmes de surveillance qui nous entourent. Le coût social de la répression du vol alimentaire est bien plus élevé, et profondément inquiétant, parce qu’il produit des effets inégaux selon les communautés ».
Elle ajoute: « Les hausses signalées du vol alimentaire au Canada sont liées à la pression de l’inflation ainsi qu’à la diminution des investissements dans les soutiens sociaux comme le logement, la santé mentale, le transport et les services communautaires. »
À la fin décembre 2025, différents médias rappelaient que seulement cinq grands détaillants contrôlent plus de 80 % du marché de l’alimentation au Canada. Sobeys, Loblaws et Metro, à eux seuls, ont engrangé des profits de $4,3 milliards cette année.
Ce rapport de force-là se joue jusque dans les nécessités les plus élémentaires de la vie quotidienne.
Il existe autant de raisons de ne pas allaiter que de configurations de vie, de corps et de contraintes sociales qui peuvent l’empêcher. Beaucoup de femmes ont recours au lait maternel de substitution, et si on en rend l’obtention matériellement difficile, peut-on encore parler de crime lorsqu’une femme a recours au vol dans le but de nourrir son enfant?
L’incarcération des femmes est la prolongation institutionnelle de la pauvreté et de la violence étatique. Derrière les discours sur la prétendue responsabilité individuelle se cachent presque toujours des trajectoires marquées par les violences conjugales ou familiales, la charge parentale et la santé mentale fragilisée. Punir ces femmes coûte infiniment plus cher que de garantir les conditions minimales de leur existence, mais la punition demeure politiquement rentable, car celle-ci semble rassurer une bonne partie de la population en marquant au fer une coupable.
C’est le monde miroir, alors que les vraies atrocités de notre temps se commettent de manière évidente par ceux et celles au pouvoir.
Vous appréciez cette chronique ? Partagez-la avec un·e ami·e !


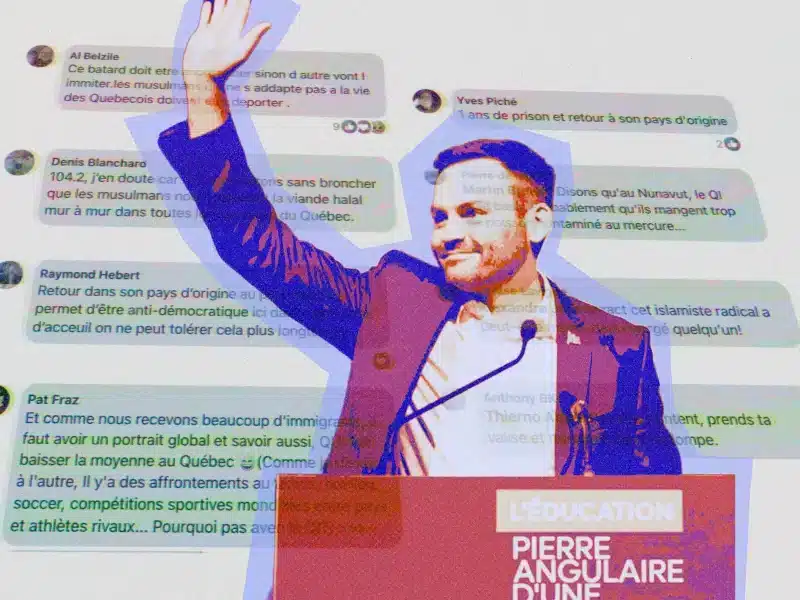

Bon article et redirection de la pensée populaire. Mais est-ce un argument économique pour le soutien aux femmes ? Coût de l’incarcération vs coût de la formule pour bébé ? Je trouve ça bizarre, dans notre société d’aujourd’hui, que l’on ne veille pas simplement à la santé des femmes et de leurs enfants. Pourquoi avons-nous besoin de cette redirection ? Avons-nous perdu le fil du dollar et des profits/bénéfices des entreprises ? On punit des femmes, des enfants et leurs familles pour les péchés des entreprises, plutôt que de tenir celles-ci responsables de leurs impacts sociaux.
Je trouve troublant qu’on doive défendre le soutien aux femmes et aux enfants par des arguments économiques. On hésite à investir quelques milliers de dollars en prévention, mais on accepte de dépenser plus de 100 000 $ par an en incarcération ou en gestion de crise lorsque le soutien fait défaut. Ce n’est pas un problème de coûts, mais de priorités. Une société qui finance la punition plutôt que le soin fabrique les crises qu’elle prétend ensuite résoudre. Pourquoi le care doit-il être rentable pour être légitime ?